L’inceste, enfin entendu
La parole des victimes d’inceste se libère sur la Toile depuis les révélations de Camille Kouchner et l’apparition du hashtag #MeTooInceste. De témoignages en témoignages, de générations en générations, la prise de conscience se consolide.
«Ça m’a mis une vraie claque». Ielena, 27 ans, publie des vidéos sur les réseaux sociaux depuis cinq ans pour sensibiliser au crime dont elle a été victime enfant : des viols perpétrés par son grand-père. Début janvier, face à la vague de témoignages d’autres victimes avec le hashtag #MeTooInceste sur Twitter, elle a d’abord été tétanisée. Beaucoup d’émotions, de souvenirs qui remontent. Trop pour «quelqu’un qui a vécu l’inceste». Le courant l’a poussée, elle s’est dit que c’était «super», que quelque chose allait se passer. La jeune femme s’est laissée emmener par cette vague. Invitée dans la presse et sur les plateaux pour parler de la pédocriminalité incestueuse qu’elle a subi de dix à quinze ans.
«#MeTooInceste, c’est un éveil des consciences et enfin l’acceptation de la parole des victimes», résume Ielena, comme si elle avait pu synthétiser cette dynamique qui a mis un coup à l’omerta autour de l’inceste.
Familia Grande
Le mouvement a été déclenché par la publication du livre de Camille Kouchner, la Familia Grande, le 7 janvier 2021. Le témoignage d’un inceste d’une autre époque, les années 1980. Avec un bourreau présumé d’une autre génération : le politologue septuagénaire Olivier Duhamel. Une affaire qui symbolise l’évolution qui s’est opérée autour du traitement de l’inceste depuis quarante ans.
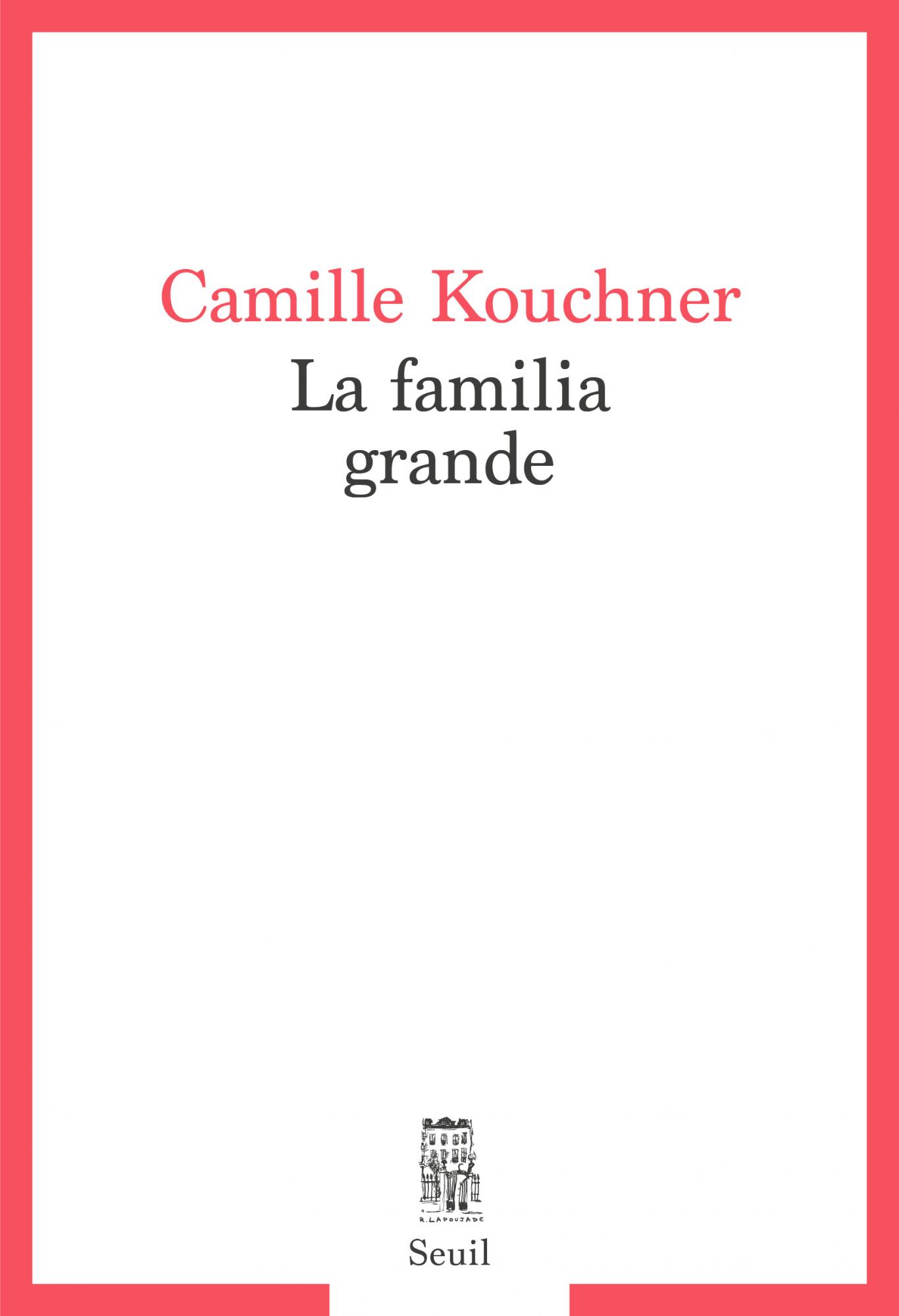
«Prendre la parole en tant que victimes a longtemps été difficile, car ces dernières n’étaient pas crues», analyse le sociologue Pierre Verdrager, auteur de «L’enfant interdit : Comment la pédophilie est devenue scandaleuse» (Armand Colin, 2013). «Seulement récemment, on commence à les prendre au sérieux». Il cite l’exemple d’Eva Thomas, première femme à avoir témoigné d’inceste à visage découvert sur un plateau télé en France, en 1986. Les téléspectateurs de l’époque ont réagi en direct et plusieurs ont minimisé sa souffrance. «J’ai des relations quotidiennes avec ma fille de 13 ans, pourquoi empêchez-vous les gens d’être heureux ?» demandait d’un ton accusateur un ingénieur, au standard téléphonique de l’émission de France TV.
Ielena le sait : si elle a pu parler, être écoutée et même intenter un procès contre son grand-père, sa mère Christelle n’a pas pu en faire autant. Elle avait aussi subi des agressions sexuelles de la part du même homme, son père. C’était à la fin des années 1970. Elle avait sept ans quand cela a commencé. Dix ans quand cela s’est terminé. Même si cela ne s’arrête jamais vraiment.
Christelle raconte avoir eu l’impression que «ce n’était pas grave, tout sauf un crime». Longtemps elle s’est tue. Jusqu’à ses 24 ans, alors qu’elle était déjà mère. Elle a réuni sa famille, a dénoncé son père et s’est faite traiter de folle. «Ça a été catastrophique», répète-t-elle quatre fois de suite, la voix tremblante.
«Moi-même, et des personnes plus âgées, ont remis en cause la gravité de ce qui m’était arrivée», se souvient Ielena. Dans les commentaires de ses vidéos Youtube, on lui écrit que ce qu’elle appelle «viol» et «inceste» est en fait une forme «d’éducation à la sexualité» (sic) inculquée par un proche de confiance. «L’éducation à la sexualité», un argument qui se retrouve aussi dans les réactions au témoignage médiatisé d’Eva Thomas en 1986.

Interdit d’interdire
Des remarques qui dénotent avec le ton actuel, mais qui étonnent peu quand on étudie l’Histoire des mœurs depuis mai 68. «Dans les années 1970-1980, on a assisté à une tentative de valorisation et de légitimation de ces relations, par une certaine élite intellectuelle», retrace le sociologue, Pierre Verdrager. C’était l’époque de la libération des mœurs et de la sexualité. Aux nouvelles revendications LGBT se mêlaient aussi celles des défenseurs de la pédophilie et de l’inceste, explique le sociologue auteur de L’enfant interdit : Comment la pédophilie est devenue scandaleuse. Comme s’ils étaient de natures comparables.
En 1981, le quotidien Le Monde titrait «L’inceste, dernier tabou». Les lignes et les témoignages y sont univoques : l’interdit universel que décrivait l’anthropologue Claude Lévi-Strauss en 1967 pourrait être dépassé. «L’inceste est à la mode (…) Est-ce à dire que ce dernier tabou est en train de disparaître ? Qu’après les rapports sexuels préconjugaux, l’adultère et l’homosexualité, l’inceste se banalise et devient acceptable pour notre société permissive ? À première vue, l’hypothèse est plausible», imprime le journal du soir. Il n’était pas alors question du tabou qui pesait sur la souffrance des victimes et les enfermait dans le secret.
La honte change de camp
Plusieurs évènements déclenchent progressivement une prise de conscience et de parole sur les violences sexuelles. Souvent, c’est en mettant en lumière un crime commis par un homme plus âgé, que les témoignages se multiplient au présent : DSK, Weinstein et #Metoo, le procès Barbarin, le récit de Vanessa Springora qui déclenche l’affaire Matzneff.
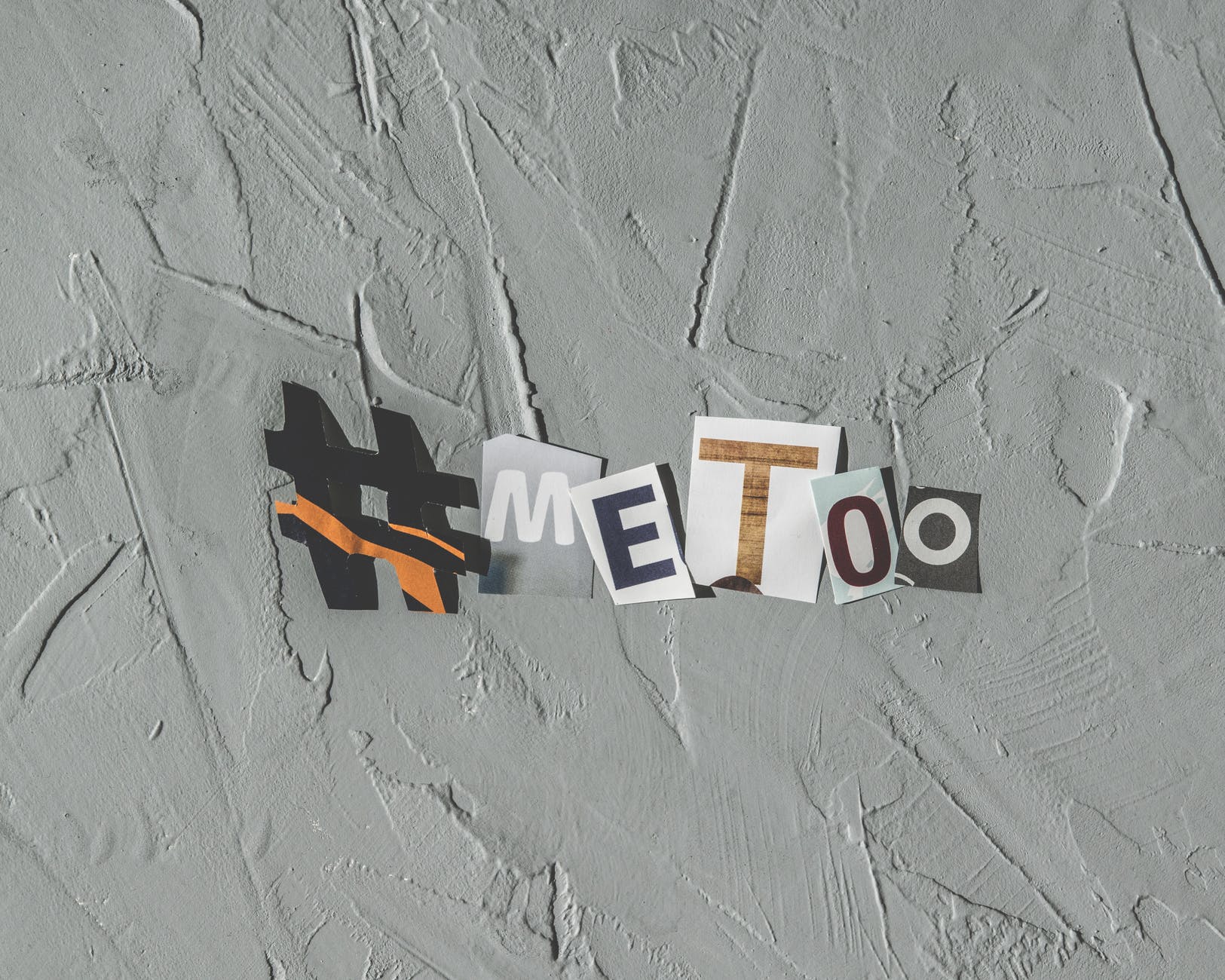
Dernière étape : l’inceste. Avec #MeTooInceste, le sujet s’est imposé sur les bureaux de l’Élysée. Samedi 23 janvier, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, le Président a assuré aux victimes d’incestes : «On est là. On vous écoute. On vous croit. Et vous ne serez plus jamais seuls». Emmanuel Macron s’est engagé à accompagner la libération des paroles et à mieux punir les criminels. En 2020, un Français sur dix affirmait avoir été victime d’inceste durant son enfance.
Une parole en libère une autre
C’est entendre l’histoire des autres, qui a permis à Christelle de raconter la sienne. De sept à dix ans, la mère d’Ielena a subi des attouchements de la part de son père. «Mon père me disait que c’était normal, et autour de moi personne n’en parlait, même pas mes copines», explique la femme de 49 ans. C’est face à une interview télévisée de personnes touchées par l’inceste qu’elle commence à se « éveiller», explique-t-elle. «Comme quoi la télé, ça peut aider !», souligne la mère de trois enfants, en essayant de dédramatiser la conversation. Elle dit avoir été retenue par un lourd sentiment de honte et un manque de courage. Elle n’aosé en parler à sa famille qu’une dizaine d’années plus tard. «Ils m’ont répondu par des cris, des hurlements, ils n’ont pas accepté, et j’ai décidé de me taire à tout jamais», se souvient Christelle.
Si aujourd’hui elle se confie à nouveau, c’est grâce au combat de sa fille. Quand Ielena lui raconte, alors qu’elle a 17 ans, que son grand-père a abusé d’elle, Christelle sort de son silence. Elle raconte son histoire à sa fille pour la première fois et l’encourage, elle, à porter plainte. «Ma mère m’a dit que je lui avais redonné la force de parler», confirme Ielena.
Si Christelle a réussi à libérer sa parole, elle reste pessimiste quant au mouvement #MeTooInceste. «C’est encore très tabou, les mentalités ne changent pas tant que ça», nuance-t-elle. Christelle doute de l’impact que peut avoir le mouvement Twitter sur les enfants. «Ce n’est pas ça qui permet aux enfants de pouvoir se libérer de l’emprise d’un de leurs parents», s’inquiète la mère de famille.
Pour Arnaud Gallais, cofondateur du collectif Prévenir et Protéger qui réunit des associations de lutte contre les violences faites aux enfants et aux femmes, les mots sur les réseaux sociaux sont un espoir pour «modifier la mémoire collective». Dans son enfance, il a lui-même été victime d’incestes, de la part d’un grand-oncle puis de cousins.
Il estime que le tabou perdure si les lois ne changent pas. Avec son collectif d’associations, il demande des actions concrètes. Déjà, le seuil d’âge de non-consentement à quinze ans. Un débat d’actualité, alors que le Sénat a voté à l’unanimité, jeudi 21 janvier, un projet de loi visant à créer un nouvel article dans le Code pénal pour «affirmer l’interdiction absolue de tout acte sexuel entre une personne majeure et un mineur de moins de 13 ans». Pour Arnaud, ce n’est pas assez. Auditionné par Isabelle Santiago, la députée socialiste qui porte ce texte à l’Assemblée nationale, il a demandé à pousser cette interdiction à l’âge de quinze ans, et à 18 ans dans les cas d’incestes et les mineurs vulnérables.
Le collectif Prévenir et Protéger plaide aussi pour une reconnaissance de l’amnésie traumatique des victimes et l’imprescriptibilité des crimes relatifs à l’inceste sur mineurs.
Outre la nécessité d’actions de l’État, Ielena reconnaît l’importance d’un autre vecteur de changement : l’éducation des enfants. Elle cite sans cesse l’exemple de ses deux petites sœurs, de 13 et 9 ans. Car leur mère Christelle les a explicitement sensibilisées à la question, contrairement à ce qu’elle avait fait avec Ielena il y a une quinzaine d’années. « Elles sont au courant de ce que c’est et de ce qu’il faut faire si cela leur arrive », observe-t-elle, admirative.
Pour la jeune femme, qui subit encore les effets de son traumatisme sur sa vie d’adulte (Ielena n’a pas de travail, de domicile fixe et rencontre beaucoup de difficultés sociales), c’est une source d’espoir. Elle ajoute, pour illustrer l’évolution qu’elle a observé sur trois générations, entre sa mère, elle-même et ses petites sœurs : «Si j’avais eu douze ans aujourd’hui et que mon grand-père me violait, cela ne se serait peut-être pas passé de la même manière, car j’aurais su ce qu’il se passait réellement et j’aurais pu en parler».
J.